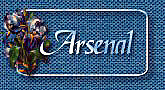I - Verchère de Reffye - 1971-1980
L’arrivée à Tarbes, l’hiver 1971, d’un personnage comme Jean-Baptiste Auguste Verchère de Reffye,
tout à la fois ingénieur militaire polytechnicien, brillant artilleur et inventeur de génie, auréolé de la confiance de Napoléon III avant sa destitution et de Léon Gambetta, après la défaite, ne
laisse pas apparaître, encore, le désir secret d’un homme qui a beaucoup dirigé des militaires et des civils, tant à l’atelier de recherches de Meudon, qu’à Paris, Nantes ou Indret, mais qui veut
constituer « son » atelier comme une micro-société qui devra aller de l’avant, toujours, pour doter la France d’un armement digne de rivaliser avec le grand ennemi. Un esprit
« commando », avant la lettre, va se révéler rapidement au service d’un capitaine d’industrie.
Alchimie mystérieuse, le site de Tarbes lui plait. La vue des Pyrénées, peut-être, les fouilles
archéologiques préhistoriques sur le camp de Ger en compagnie de son ami, le colonel Pothier, alsacien comme lui, la population rurale, attachante, une ville de moins de 16000 habitants où il a opté
pour la nationalité française, en 1872, et qui ne demande qu’à sortir de son Moyen-Age industriel. Pendant les deux années 1873-1874, il embauche 2000 ouvriers non spécialisés (manœuvres), dans les
H.P, pour un effectif total de 2400 salariés.
Une volonté d’implantation - Le quartier Saint-Antoine
Alors que les prix des premiers terrains achetés par l’État s’envolent, Reffye craint la surenchère
d’un spéculateur sur le prix de 10000 F, l’hectare, estimé par l’État et que le comptable public ne peut pas dépasser. Il s’agit, ici, des parcelles les mieux côtées qui longent la route
Tarbes-Vic-en-Bigorre et qui sont la propriété du baron Charles de Clarac, la comtesse de Galard et les enfants mineurs du baron de Marignan. La minorité de ces enfants obligera la vente aux enchères
publiques. Pour le Lieutenant-colonel, cet achat est primordial car il veut installer les familles d’ouvriers dans une maison modeste, certes, mais agrémentée d’un petit jardin. Il voit là le moyen
de fidéliser une main-d’œuvre précieuse, venue d’Alsace et de Lorraine, provinces françaises concédées à l’ennemi : « Il y aurait intérêt à fixer cette population industrielle,
laborieuse et tranquille et le meilleur moyen d’y parvenir c’est d’assurer leur bien-être et de les sauvegarder contre l’exploitation des spéculateurs », écrit-il au Ministre. Il propose
aux ouvriers ce type de loyer avec une diminution de salaire, librement consentie, afin que l’État rentre dans son débours et rende le terrain disponible pour le besoin d’une éventuelle extension.
Par cette proposition acceptée par le Ministre (6ha = 50000 F), Verchère de Reffye contribue à l’implantation d’une soixantaine de familles d’Alsaciens dans le quartier Saint-Antoine, essentiellement
rural.
Humaniste et social
27/02/1873 : Verchère de Reffye pense à prémunir « ses » ouvriers contre
les accidents, la maladie, l’indigence.
Soins immédiats
Il s’enquiert de médecins et de chirurgiens pouvant être contactés pour une intervention et de
pharmaciens qui fourniront gratuitement des médicaments. Il enrôle 1 chirurgien et 2 médecins.
Sécurité sociale et prévoyance
Il crée une caisse de sécurité, appelée très justement « Masse de Prévoyance »,
pour amortir les conséquences des accidents et maladies contractés à l’Arsenal. Soins gratuits en cas de maladie, secours en nature ou en argent pour une aide aux ouvriers en état
d’indigence.
Il retient 8% sur le bulletin de paie, montant versé à la Caisse des dépôts et consignations,
restitué à l’ouvrier lors de sa sortie de l’Arsenal et abondé des intérêts du capital constitué. Une bourse de prévoyance qui permet d’amortir une reprise d’activité
aléatoire.
25/07/1874 : Il fonde l’Ecole d’apprentis mécaniciens pour les enfants d’ouvriers – éducation
+ instruction – âgés de 12 ans.
Contreparties
Il instaure un règlement avec une discipline stricte qui exige le respect envers les femmes et les
enfants. Les enfants de 12 ans travaillent 6 h/jour, 13 à 16 ans = 12 h/jour et les adultes peuvent travailler la nuit et le dimanche. Le service d’exercice pour combattre les incendies est
obligatoire, par équipes, le dimanche matin. Et non rémunéré.
Conséquences
Une véritable « fusion » s’établit entre les ouvriers et de Reffye. La
conscience collective d’une nécessaire bonne exécution du travail s’instaure rapidement et durablement. Pour les ouvriers et employés,
l’Arsenal est « une affaire de famille » (3 générations, parfois). Ce sentiment, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, fera de l’ATS, une entreprise unique dans le sud de la
France comparable, peut-être, à Michelin, à Clermont-Ferrand.
La ville de Tarbes dont la population est de 16500 habitants, en 1872, progressera jusqu’à 28500
habitants, en 20 ans. Le mouvement des ruraux qui viennent travailler en ville, amorcé depuis une cinquantaine d’années, s’accélère brutalement avec ce formidable appel de
l’Arsenal.
II – La voie est tracée
Dépression de l’effectif ouvrier de 1881 à 1892. Reprise en 1895.
1/06/1895 : Affiliation des ouvriers civils à la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse. Le capital versé est réservé et l’entrée en jouissance de la pension viagère est fixée à 60 ans et peut être retardée jusqu’à 65 ans.
26/10/1898 : Un second médecin (Dr Brachet) est adjoint au docteur
Vignes.
1910 : Salaire moyen/jour, pour l’ensemble des personnels = 5,50 F (H = 6,30 F, F = 3
F).
1914 : Salaire moyen/jour, pour l’ensemble des personnels = 6,25
F.
Chefs d’équipe = 10 à 15 F, chefs d’ateliers = 16 F, contremaîtres = 24
F.
Comparaison avec la Compagnie des chemins de fer du Midi, l’Usine à gaz, petits industriels et
entrepreneurs (habillement, construction, alimentation) :
Manœuvres = 3 F/jour ATS = 3,50 à 4 F/jour
Usine à gaz = 3,75 F/jour
Les femmes en couches reçoivent un secours de 50 F.
1912 : 9 médecins sont reconnus par l’ATS pour intervention sur les arsenalistes à Tarbes,
Séméac, Aureilhan, Bordères, Laloubère (2297 sur 2448), le reste à Lourdes, Tournay, Vic-Bigorre, etc.
La grande guerre : 1914-1918
1914-1918 : L’effectif ATS passe de 2412 (1914) à près de 16000 (1916). La ville de Tarbes et
ses 30000 hab, environ, bondit à 46000 hab et les loyers sont hors de prix.
Décembre 1917 : Création d’un restaurant coopératif (angle rue Clarac et rue Massey) qui prend
le nom « La Prolétarienne de Tarbes » pouvant recevoir 1200 clients/jour. L’objectif est de loger, nourrir et « faire boire » les arsenalistes. Certains soldats
et prisonniers de guerre de l’Arsenal y trouveront un abri et un réconfort pendant quelques jours, à leur retour.
1918 : Les femmes employées à la Pyrotechnie, ont doublé leur salaire, jusqu’à 3,50 F/jour.
Pour un accouchement, le salaire est entier pendant 4 des 8 semaines d’interruption du travail, et le demi salaire pendant les 4 autres semaines.
La guerre 1939-1945
1945 : Service médical
1 médecin chef, 1 médecin du travail, 1 médecin médecine générale (consultations), 1 médecin pour
le contrôle des maladies à domicile.
1 dispensaire, 1 cabinet dentaire, 1 service social et 3 assistantes, 1 Comité Hygiène et sécurité,
1 Caisse de solidarité (1949) et 1 bibliothèque, en 1952.
Sont organisées par l’Edelweiss, des sorties skis, l’hiver, montagne et mer, l’été. Des
convalescences au château de Lascazères et Oléac-Debat (Achille Fould) pour les P.G.
1946 : Ecole Technique Normale de Tarbes avec les professeurs de l’E.N.P de Tarbes. Un ouvrier
peut devenir technicien diplômé (ETN) ou ingénieur diplômé (ETS).
GIAT Industries – 1990-2006
1/01/1996 : 1860 salariés = 56% de l’effectif industriel de
Tarbes.
62 entreprises sous-traitantes pour un effectif de 923 salariés.
1000 commerces et 510 entreprises de service sont indirectement
concernés.
Selon la CCI, le démantèlement de GIAT est une perte de 30% d’emplois industriels à
Tarbes.
Claude Larronde
Texte préparé pour les journalistes de « La Nouvelle République des Pyrénées »,
« La Dépêche du Midi » et « La Semaine des Pyrénées ».